Ernst Cassirer, dans son oraison funèbre, souligne que le « regard de Warburg (qu’il compare à Giordano Bruno),] ne se portait pas en premier lieu sur les œuvres d’art :
 Je voyais à cet instant se dresser devant moi le problème qui avait saisi sa vie et l'avait consumée, tout son sérieux, sa force et sa grandeur tragique. [...] Là où d'autres avaient vu des formes déterminées, délimitées, des formes reposant en elles-mêmes, il voyait des forces mouvantes, il voyait ce qu'il appelait les grandes "formes du pathos" que l'Antiquité avait créées comme patrimoine durable de l'humanité. [...] Il puisait ici dans sa propre expérience vécue la plus profonde En lui-même, il avait fait l'expérience et appris ce qu'il voyait devant lui - et il n'était en mesure de voir vraiment que ce qu'il était en mesure de saisir et d'interpréter, à partir du centre de son être propre et de sa propre vie. "Tôt, il avait lu la parole sévère - il était familier de la souffrance, familier de la mort." Mais au cœur de cette souffrance, lui vinrent la force et la particularité incomparables du regard. Rarement chercheur avait davantage et plus profondément dissout sa souffrance la plus profonde en regard et l'y avait libérée. [...] Il se tenait toujours au milieu de la tempête et du tourbillon de la vie même ; il pénétrait jusqu'en ses problèmes tragiques ultimes et les plus profonds. Et il y avait avant tout un problème auquel il revenait toujours et avec lequel il a lutté inlassablement jusqu'à la fin. Dans son discours sur Shakespeare, le jeune Goethe affirme que les plans de Shakespeare, pour le dire de manière ordinaire, ne sont pas des plans, ses pièces tournant toutes autour de ce point secret qu'aucun philosophe n'a encore perçu et déterminé, où se rencontre la particularité de notre Je, la liberté prétendue de notre volonté et la marche nécessaire du tout. La recherche de Warburg était elle aussi en permanence orientée vers ce "point secret" et, comme sous le charme, son regard y était attaché. »
Je voyais à cet instant se dresser devant moi le problème qui avait saisi sa vie et l'avait consumée, tout son sérieux, sa force et sa grandeur tragique. [...] Là où d'autres avaient vu des formes déterminées, délimitées, des formes reposant en elles-mêmes, il voyait des forces mouvantes, il voyait ce qu'il appelait les grandes "formes du pathos" que l'Antiquité avait créées comme patrimoine durable de l'humanité. [...] Il puisait ici dans sa propre expérience vécue la plus profonde En lui-même, il avait fait l'expérience et appris ce qu'il voyait devant lui - et il n'était en mesure de voir vraiment que ce qu'il était en mesure de saisir et d'interpréter, à partir du centre de son être propre et de sa propre vie. "Tôt, il avait lu la parole sévère - il était familier de la souffrance, familier de la mort." Mais au cœur de cette souffrance, lui vinrent la force et la particularité incomparables du regard. Rarement chercheur avait davantage et plus profondément dissout sa souffrance la plus profonde en regard et l'y avait libérée. [...] Il se tenait toujours au milieu de la tempête et du tourbillon de la vie même ; il pénétrait jusqu'en ses problèmes tragiques ultimes et les plus profonds. Et il y avait avant tout un problème auquel il revenait toujours et avec lequel il a lutté inlassablement jusqu'à la fin. Dans son discours sur Shakespeare, le jeune Goethe affirme que les plans de Shakespeare, pour le dire de manière ordinaire, ne sont pas des plans, ses pièces tournant toutes autour de ce point secret qu'aucun philosophe n'a encore perçu et déterminé, où se rencontre la particularité de notre Je, la liberté prétendue de notre volonté et la marche nécessaire du tout. La recherche de Warburg était elle aussi en permanence orientée vers ce "point secret" et, comme sous le charme, son regard y était attaché. »
la conférence de 1923 prononcée à la clinique Bellevue, fait œuvre décisive, œuvre de fondation. Warburg y fait d'une « régression » une « invention » : il retourne aux éblouissements de son périple passé en territoire Hopi, pour se donner - à travers la folie(« La confession) d'un schizoïde (incurable), versée aux archives des médecins de l'âme ») - les conditions d'un renouvellement et d'un approfondissement de toute sa recherche. C'est à sa sortie de Kreuzlingen, en effet, qu'il entreprendra, malgré les difficultés de son état, des chantiers dont la fécondité laisse stupéfait : Mnemosyne, mais aussi les écrits théoriques, les séminaires sur la méthode, les incursions dans l'histoire contemporaine, les expositions...g.didi-huberman souligne à ce sujet :
« C'est à un extraordinaire travail d'anamnèse qu'il aura - grâce à Binswanger - procédé, remontant le chemin de l’épreuve à l'expérience, et de celle-ci à la connaissance. Connaissance d'un style nouveau (voilà notre fameuse « science sans nom »), puisqu'elle tirait de sa propre mise en péril les fondements de son efficacité. Connaissance capable de transformer la « confession (d'un schizoïde » en théorie culturelle des schizes symboliques. »
Warburg avait tenté de comprendre l’art au sein de l'ensemble de la culture, étudiant ses mécènes et son public, ainsi que ses fonctions particulières dans le rituel, les fêtes et les nouvelles pratiques d'exposition de soi. Il allait maintenant comprendre l’Europe à partir de l’Amérique par un regard d’anthropologue. Mais l'anthropologie, telle que Warburg la conçoit, signifiait plus que ce simple élargissement de l'objet de la recherche. D'abord et surtout, elle désignait un point de vue particulier sur l'objet : celui de l'« étranger ». Acquise à l'origine dans la rencontre avec des peuples « primitifs » (Warburg lui-même a parfois employé ce terme entre guillemets), la perspective détachée des anthropologues pouvait être appliquée chez soi, à sa propre culture, en traitant sans passion ce qui est familier, comme on le ferait de quelque chose d'étranger ou encore en explorant le passé historique de ce qui est familier. Par exemple, contre l'image de la Renaissance considérée comme un âge étrangement semblable au nôtre, et donc comme un fonds immédiatement disponible de valeurs intemporelles, Warburg fait le portrait d'une époque exotique où les chefs-d'œuvre que nous admirons aujourd'hui étaient masqués par un fouillis de rituels éphémères, et où la rationalité moderne émergeait, étroitement associée à la résurgence de la magie païenne, de l'alchimie et de l'astrologie
 « Ce que j'ai donc vu et vécu ne rend que l'apparence superficielle des choses dont j'ai à présent le droit de parler, si je commence par dire que le problème insoluble qu'elles posent a pesé sur mon âme de façon si oppressante que je n'aurais jamais osé m'exprimer en scientifique à ce sujet à l'époque où j'étais en bonne santé. Mais à présent, en 1923, en mars, à Kreuzlingen, dans un établissement fermé, où j'ai l'impression d'être un sismographe fabriqué à partir de morceaux de bois provenant d'une plante transplantée de l'Orient dans la plaine nourricière de l'Allemagne du Nord, et sur laquelle on a greffé une branche venant d'Italie, je laisse sortir de moi les signes que j'ai reçus»
« Ce que j'ai donc vu et vécu ne rend que l'apparence superficielle des choses dont j'ai à présent le droit de parler, si je commence par dire que le problème insoluble qu'elles posent a pesé sur mon âme de façon si oppressante que je n'aurais jamais osé m'exprimer en scientifique à ce sujet à l'époque où j'étais en bonne santé. Mais à présent, en 1923, en mars, à Kreuzlingen, dans un établissement fermé, où j'ai l'impression d'être un sismographe fabriqué à partir de morceaux de bois provenant d'une plante transplantée de l'Orient dans la plaine nourricière de l'Allemagne du Nord, et sur laquelle on a greffé une branche venant d'Italie, je laisse sortir de moi les signes que j'ai reçus»
. La conférence de LA CLINIQUE Bellevue est un mouvement sismographique entre l’Europe et l’indianité. Warburg y explique ce qu'il voit à Oraibi(le village pueblo) par ce qu'il sait de l'Antiquité et applique ensuite à l'Antiquité ce qu'il sait d'Oraibi. L'exergue de la conférence dessine ce cercle : « C'est un vieux livre à feuilleter / Athènes-Oraibi, tous cousins. » Warburg adapte deux vers du Faust de Goethe, où Méphistophélès découvre que les démons de la « Nuit classique de Walpurgis » sont apparentés à ses homologues allemandes (les sorcières du Harz) et s'exclame : « C'est un vieux livre à feuilleter / Du Harz à l'Hellade, toujours des cousins. »
 Même si certains accents semblent céder à une nostalgie primitiviste, (Warburg exprime véritablement sa méfiance à l'égard de la technologie moderne et sa sympathie pour un « passé mythique » et « auratique » au sens de Benjamin), tel n’est pourtant pas son propos et l’oscillation demeure qu’il exprime dans une phrase énigmatique à propos de Luther : « Car il faut sans cesse reconquérir Athènes(la raison) depuis Alexandrie(le cultuel magique) »
Même si certains accents semblent céder à une nostalgie primitiviste, (Warburg exprime véritablement sa méfiance à l'égard de la technologie moderne et sa sympathie pour un « passé mythique » et « auratique » au sens de Benjamin), tel n’est pourtant pas son propos et l’oscillation demeure qu’il exprime dans une phrase énigmatique à propos de Luther : « Car il faut sans cesse reconquérir Athènes(la raison) depuis Alexandrie(le cultuel magique) »
Par un paradoxe dialectique, tandis que son œuvre historique cherche à mettre le familier à distance, en révélant les fractures qui menacent la façade de la raison, dans le « rituel du serpent, à l’inverse, il cherche le familier dans l'étrange. Au lieu de rejeter les rituels hopis comme des superstitions et, par conséquent, comme étrangers et inférieurs à la rationalité, il découvre qu'ils contiennent eux aussi une logique dirigée vers des fins pratiques : la maîtrise de l'angoisse, l'abondance des récoltes, l'expression de la piété.
Le rituel
 Les serpents sont capturés au mois d'août, au milieu du désert, au moment où les pluies doivent venir ; les trois premiers jours du rituel sont consacrés à leur recherche, qui alterne avec des phases de prière dans les kiwas. Les chasseurs de serpents sont vêtus d'un kilt et portent des mocassins, ils sont marqués de peinture rosé en haut et en bas des membres, sur le front et de chaque côté du sternum et de l'épine dorsale. En 1891, une soixantaine de serpents furent utilisés, dont quelque deux tiers étaient des serpents à sonnettes). Jusqu'à la cérémonie, on les conserve dans des jarres, dans l'obscurité de la kiwa. Les reptiles ne sont pas nourris tant qu'ils sont confinés, leur poison n'est pas extrait, ils sont traités avec le plus grand soin et la plus grande douceur, on évite les mouvements rapides et nul n'élève la voix à proximité. Si un serpent s'échappe du sac où il est enfermé : le chasseur qui l'avait capturé la veille, l'appelant « mon animal », le retrouve à son bruit et le remet dans un des sacs contenant les serpents.
Les serpents sont capturés au mois d'août, au milieu du désert, au moment où les pluies doivent venir ; les trois premiers jours du rituel sont consacrés à leur recherche, qui alterne avec des phases de prière dans les kiwas. Les chasseurs de serpents sont vêtus d'un kilt et portent des mocassins, ils sont marqués de peinture rosé en haut et en bas des membres, sur le front et de chaque côté du sternum et de l'épine dorsale. En 1891, une soixantaine de serpents furent utilisés, dont quelque deux tiers étaient des serpents à sonnettes). Jusqu'à la cérémonie, on les conserve dans des jarres, dans l'obscurité de la kiwa. Les reptiles ne sont pas nourris tant qu'ils sont confinés, leur poison n'est pas extrait, ils sont traités avec le plus grand soin et la plus grande douceur, on évite les mouvements rapides et nul n'élève la voix à proximité. Si un serpent s'échappe du sac où il est enfermé : le chasseur qui l'avait capturé la veille, l'appelant « mon animal », le retrouve à son bruit et le remet dans un des sacs contenant les serpents.
La phase active du rituel commence au cinquième jour. Une peinture de sable représentant le monde hopi est tracée sur le sol de la kiwa:  à l'intérieur d'une bordure constituée de plusieurs lignes de couleur géométriques, sur un fond de sable brun, apparaissent les quatre symboles de l'éclair en forme de serpents Leur corps dessine un quadruple zigzag entre des motifs en demi-lune représentant les nuages ; leur tête triangulaire pointe vers l'est. Une quarantaine de lignes parallèles, tracées avec du sable noir, représentent la pluie. Le prêtre-peintre ne trace aucune esquisse préliminaire pour déterminer la taille de ses figures, à aucun moment il ne touche directement le sol, se contentant de laisser glisser le sable entre ses doigts. Il n'utilise ni règle, ni corde, ni aucun autre instrument de mesure.
à l'intérieur d'une bordure constituée de plusieurs lignes de couleur géométriques, sur un fond de sable brun, apparaissent les quatre symboles de l'éclair en forme de serpents Leur corps dessine un quadruple zigzag entre des motifs en demi-lune représentant les nuages ; leur tête triangulaire pointe vers l'est. Une quarantaine de lignes parallèles, tracées avec du sable noir, représentent la pluie. Le prêtre-peintre ne trace aucune esquisse préliminaire pour déterminer la taille de ses figures, à aucun moment il ne touche directement le sol, se contentant de laisser glisser le sable entre ses doigts. Il n'utilise ni règle, ni corde, ni aucun autre instrument de mesure.
À l'exécution de la peinture succède un rituel d'initiation pour lequel les novices, les prêtres et les spectateurs, hommes et femmes, se rassemblent dans la kiwa du serpent. 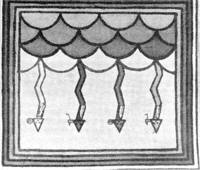 Une bâche est tendue de mur à mur, dissimulant les jarres où les serpents ont été placés et formant une sorte de coulisse pour les danseurs. Le chef des serpents se tient dans un angle de la pièce, enveloppé dans une couverture. Au signal, alors que les prêtres commencent à murmurer des chants incantatoires, un acteur-danseur surgit à reculons, les jambes fléchies, de la toile tendue au milieu de l'espace. Il porte une parure de plumes et son visage est peint. Il s'approche d'abord du foyer où un feu est allumé, s'empare d'une pipe et se met à danser en fumant. Puis il disparaît derrière l'écran qui traverse la pièce et réapparaît un instant plus tard, sans cesser de danser. Il s'approche du chef de la confrérie, les jambes toujours fléchies, et tire de sous la couverture une branche morte, s'approche des novices et l'agite devant leur visage. Puis il se retire à nouveau derrière la bâche et, à sa place, un nouvel acteur, «l'homme-puma», apparaît. Par deux fois, tandis que les prêtres répandent de la farine de maïs sur la peinture de sable, il glisse la tête sous la couverture du chef et ramène successivement une pipe allumée, puis un serpent qui se tord dans sa bouche. S'approchant à son tour des novices, il se penche et balance l'animal de haut en bas, jusqu'à toucher leurs genoux. Le reptile rapporté au chef des serpents, le danseur se retire derrière la bâche. D'autres danseurs exécutent les mêmes gestes, sortant de la couverture alternativement des épis de maïs et des serpents vivants.
Une bâche est tendue de mur à mur, dissimulant les jarres où les serpents ont été placés et formant une sorte de coulisse pour les danseurs. Le chef des serpents se tient dans un angle de la pièce, enveloppé dans une couverture. Au signal, alors que les prêtres commencent à murmurer des chants incantatoires, un acteur-danseur surgit à reculons, les jambes fléchies, de la toile tendue au milieu de l'espace. Il porte une parure de plumes et son visage est peint. Il s'approche d'abord du foyer où un feu est allumé, s'empare d'une pipe et se met à danser en fumant. Puis il disparaît derrière l'écran qui traverse la pièce et réapparaît un instant plus tard, sans cesser de danser. Il s'approche du chef de la confrérie, les jambes toujours fléchies, et tire de sous la couverture une branche morte, s'approche des novices et l'agite devant leur visage. Puis il se retire à nouveau derrière la bâche et, à sa place, un nouvel acteur, «l'homme-puma», apparaît. Par deux fois, tandis que les prêtres répandent de la farine de maïs sur la peinture de sable, il glisse la tête sous la couverture du chef et ramène successivement une pipe allumée, puis un serpent qui se tord dans sa bouche. S'approchant à son tour des novices, il se penche et balance l'animal de haut en bas, jusqu'à toucher leurs genoux. Le reptile rapporté au chef des serpents, le danseur se retire derrière la bâche. D'autres danseurs exécutent les mêmes gestes, sortant de la couverture alternativement des épis de maïs et des serpents vivants.
 À une heure de l'après-midi, les prêtres se rassemblent au fond de la kiwa, près des jarres où les serpents sont conservés. On apporte un récipient de terre dans lequel un liquide est solennellement versé. Les prêtres du serpent commencent à prendre les reptiles, deux par deux, en les tenant par le cou. La tête des serpents, malgré leur résistance, est immergée plusieurs fois dans le récipient, puis ils sont jetés avec violence sur le sol de la kiwa, au milieu de la peinture. Tandis que les serpents se contractent, les prêtres, avec un bâton orné de plumes (nakwakwoci), les font rouler dans le sable. L'opération se répète jusqu'à ce que tous les serpents aient été lancés : « Les saints-serpents de pluie, vivants dans la forme de l'animal », selon les termes de Warburg, effacent la peinture où ils étaient représentés et apparaissent, à la place de leur image, le corps enveloppé d'une gangue de sable aux couleurs de l'univers (on les récupère ensuite, ils sont replacés dans les jarres.
À une heure de l'après-midi, les prêtres se rassemblent au fond de la kiwa, près des jarres où les serpents sont conservés. On apporte un récipient de terre dans lequel un liquide est solennellement versé. Les prêtres du serpent commencent à prendre les reptiles, deux par deux, en les tenant par le cou. La tête des serpents, malgré leur résistance, est immergée plusieurs fois dans le récipient, puis ils sont jetés avec violence sur le sol de la kiwa, au milieu de la peinture. Tandis que les serpents se contractent, les prêtres, avec un bâton orné de plumes (nakwakwoci), les font rouler dans le sable. L'opération se répète jusqu'à ce que tous les serpents aient été lancés : « Les saints-serpents de pluie, vivants dans la forme de l'animal », selon les termes de Warburg, effacent la peinture où ils étaient représentés et apparaissent, à la place de leur image, le corps enveloppé d'une gangue de sable aux couleurs de l'univers (on les récupère ensuite, ils sont replacés dans les jarres.
Pourquoi les serpents, d'ordinaire, ne mordent-ils pas ? peut être selon certains observateurs, à cause des manipulations répétées auxquelles les soumettent le Indiens : avant le rituel d'initiation, ils ne brutalisent pas les serpents afin de les accoutumer à la présence des hommes. Fréquemment touchés par la pointe» des fouets, ils ne sont plus effrayés par le contact et s'habituent à voir de formes se mouvoir au-dessus d'eux. Mais la principale explication réside, dit Le photographe-ethnologue Voth, dans la manière même dont ils sont manipulés : ils ne sont jamais saisi d'un geste rapide, saccadé ou hésitant ; le mouvement de la main doit être lent et doux et la prise doit être faite lorsque le serpent n'est pas enroulé sur lui même, prêt à piquer. Voth rapporte qu'en 1896 il vit un vieil Indien presque aveugle, essayant d'attraper de serpents qui glissaient sur le sol devant lui. Guidé par la voix de ses compagnons, il allongeait la main lentement, sans hésiter, se frayant une voie ai milieu des serpents sans même distinguer leur contour.
 Au neuvième jour, la danse du serpent marque la dernière phase du rituel e se déroule publiquement: Indiens et hommes blancs y assistent. La plus grande partie de l'après-midi qui précède leur performance, le danseurs la passent dans leur kiwa, peignant leurs accessoires et s'habillant pour la cérémonie. Les serpents sont amenés sur la place à six heures. Les prêtres du serpent sont groupés par trois, le porteur, le « cajoleur » et le ramasseur. Les trios se rassemblent en ligne près du kisi, le rocher sacré autour duquel les déplacements s'organisent, le porteur s'agenouille, enfonce sa main dans la jarre, tandis que celui qui l'assiste l'agrippe par la peau de renard qui lui couvre le dos. Lorsque le porteur se relève, il tient un serpent venimeux entre ses doigts. Sans hésitation, il place l'animal dans sa bouche, le saisissant par le cou, avec ses dents ou ses lèvres.
Au neuvième jour, la danse du serpent marque la dernière phase du rituel e se déroule publiquement: Indiens et hommes blancs y assistent. La plus grande partie de l'après-midi qui précède leur performance, le danseurs la passent dans leur kiwa, peignant leurs accessoires et s'habillant pour la cérémonie. Les serpents sont amenés sur la place à six heures. Les prêtres du serpent sont groupés par trois, le porteur, le « cajoleur » et le ramasseur. Les trios se rassemblent en ligne près du kisi, le rocher sacré autour duquel les déplacements s'organisent, le porteur s'agenouille, enfonce sa main dans la jarre, tandis que celui qui l'assiste l'agrippe par la peau de renard qui lui couvre le dos. Lorsque le porteur se relève, il tient un serpent venimeux entre ses doigts. Sans hésitation, il place l'animal dans sa bouche, le saisissant par le cou, avec ses dents ou ses lèvres.  Il a les yeux fermés. Celui qui le soutient, plaçant son bras gauche autour de son cou, agite son bâton orné de plumes le long du corps du serpent pour l'apaiser et protéger le porteur. Les deux hommes font le tour de la place en progressant vers la gauche, suivis de près par le troisième, chargé de ramasser le serpent en cas de chute
Il a les yeux fermés. Celui qui le soutient, plaçant son bras gauche autour de son cou, agite son bâton orné de plumes le long du corps du serpent pour l'apaiser et protéger le porteur. Les deux hommes font le tour de la place en progressant vers la gauche, suivis de près par le troisième, chargé de ramasser le serpent en cas de chute
Après que chaque groupe a exécuté un passage, tous les porteurs jettent leur serpent à l'intérieur d'un grand cercle ménagé près du rocher sacré et, sur leur masse grouillante, les femmes répandent de la farine. Au signal, les officiants sautent dans le cercle, saisissent autant de serpents qu'ils le peuvent et les transportent en courant à travers le village, aux quatre points cardinaux, où ils les libèrent. Les serpents, dit Warburg sont relâchés par les danseurs « à la vitesse de l'éclair »: transformés par la consécration et par l'imitation dansée, ils sont renvoyés vivants, sous la forme de l'éclair, comme des messagers adressés aux orages et à la pluie.
Une série de purifications (vomissements, aspersion de cendres...) marque la fin du cérémonial.
TEXTES DE WARBURG le Rituel du Serpent editions Macula (c’est moi qui souligne certains passages)
cliquez sur la suite pour lire les extraits de la conférence
En août, quand l'agriculture est dans une situation critique parce que toute la récolte dépend de la pluie d'orage, c'est une danse avec des serpents vivants qui a lieu alternativement à Oraibi et à Walpi pour faire advenir l'orage salvateur. Alors qu'à San Ildefonso on ne voit - du moins les non-initiés - que l'imitation de l'antilope, et que dans la danse du grain le masque des danseurs ne témoigne que de leur caractère démonique de démons du grain, à Walpi on est en présence d'un stade beaucoup plus primitif de la danse magique.
 Ici les danseurs et l'animal vivant forment une unité magique. Le plus surprenant est que, dans ces cérémonies dansées, les Indiens ont su manier le plus dangereux de tous les animaux, le serpent à sonnettes, de telle sorte qu'ils le maîtrisent sans employer la force, et que la créature participe de son plein gré - ou du moins sans faire usage de ses facultés d'animal féroce si elle n'est pas excitée - à des cérémonies qui durent des jours entiers, ce qui dans la main d'Européens entraînerait certainement des catastrophes.
Ici les danseurs et l'animal vivant forment une unité magique. Le plus surprenant est que, dans ces cérémonies dansées, les Indiens ont su manier le plus dangereux de tous les animaux, le serpent à sonnettes, de telle sorte qu'ils le maîtrisent sans employer la force, et que la créature participe de son plein gré - ou du moins sans faire usage de ses facultés d'animal féroce si elle n'est pas excitée - à des cérémonies qui durent des jours entiers, ce qui dans la main d'Européens entraînerait certainement des catastrophes.
Dans les villages mokis, deux clans fournissent les participants à la fête des serpents : le clan des antilopes et celui des serpents, qui sont liés par leurs mythes totémiques à ces deux animaux.
On voit ici que, même aujourd'hui, il faut prendre le totémisme au sérieux : les hommes ne s'y contentent pas de se présenter sous des masques d'animaux, mais procèdent à des actions cultuelles avec le plus dangereux des animaux vivants, le serpent. La cérémonie des serpents à Walpi se situe entre l'empathie imitative et le sacrifice sanglant : on n'y imite pas les animaux, on les intègre sous la forme la plus directe, comme des acteurs participant au culte, non pas pour y être sacrifiés mais -à l'instar du baho1 - comme des intercesseurs, afin de faire pleuvoir.
Car la danse des serpents à Walpi est destinée à obliger les serpents eux-mêmes à intercéder. En août, quand les orages doivent arriver, on les ramasse vivants dans la plaine du désert au cours d'une période de cérémonies qui dure seize jours à Walpi. Puis ils sont conservés dans la pièce souterraine, la kiwa, sous la surveillance des chefs du clan des antilopes et des serpents, et soignés au cours de cérémonies singulières, dont le lavement des serpents est la plus importante et joue le rôle le plus étonnant pour des hommes blancs Le serpent est traité comme le novice lors des mystères, on plonge sa tête, malgré ses résistances, dans de l'eau consacrée, où ont été versées toutes sortes de médecines.
Puis on le jette sur un tableau réalisé avec du sable sur le sol de la kiwa, représentant quatre serpents-éclairs, entourant un quadrupède Dans une autre kiwa un tableau de sable représente une masse de nuages, dont sortent quatre éclairs de couleur différente, en forme de serpents, correspondant aux quatre points cardinaux Les serpents sont jetés sur ce tableau de sable avec une très grande violence, de sorte que le dessin est détruit et que le serpent se mêle au sable.
 Il me semble indéniable que c'est justement cet acte magique de lancer le serpent qui oblige celui-ci à agir en suscitant les éclairs ou en faisant tomber la pluie.
Il me semble indéniable que c'est justement cet acte magique de lancer le serpent qui oblige celui-ci à agir en suscitant les éclairs ou en faisant tomber la pluie.
C'est bien là le sens de toute la cérémonie, et les cérémonies suivantes prouvent à l'évidence que les serpents ainsi consacrés deviennent, en s'unissant aux Indiens, des faiseurs de pluie et des intercesseurs. Ce sont, sous une forme animale, des saints-serpents faiseurs de pluie .
Les serpents - et il a été démontré que parmi la centaine de reptiles figurent toute une série de vrais serpents à sonnettes avec leurs crochets à venin intacts - sont gardés dans la kiwa, et le dernier jour de la fête on les retient captifs dans un buisson qu'entouré une bande de tissu .
La cérémonie culmine dans l'action suivante : on approche du buisson, on saisit et porte le serpent vivant, puis on l'envoie dans la plaine comme messager. Les chercheurs américains décrivent cette façon de saisir le serpent à pleines mains comme un acte incroyablement impressionnant.
D'après ce que nous savons de la mythologie walpi, ce culte remonte sans aucun doute à des mythes dynastiques cosmologiques. Un récit raconte l'histoire du héros Tiyo, qui entreprend un voyage dans le monde souterrain, pour découvrir la source originelle de l'eau tant désrée. Il passe par les diverses kiwas des rois du monde souterrain, toujours accompagné d'une petite araignée femelle) qui se tient invisible sur son oreille droite et le conduit - tel un Virgile indien, le guide de Dante en Enfer. Il arrive finalement, après être passé par les deux maisons du soleil, à l'Est et à l'Ouest, dans la grande kiwa des serpents, où il reçoit le baho magique qui sert à faire la pluie et le beau temps.  Deux jeunes filles-serpents, dit le mythe, que Tiyo a ramenées avec lui du monde souterrain, mettent au monde des enfants-serpents, créatures très dangereuses, qui obligent en définitive les clans à migrer, de sorte que les serpents sont intégrés dans ce mythe à la fois comme divinités météorologiques et comme totems à l'origine des migrations du clan.
Deux jeunes filles-serpents, dit le mythe, que Tiyo a ramenées avec lui du monde souterrain, mettent au monde des enfants-serpents, créatures très dangereuses, qui obligent en définitive les clans à migrer, de sorte que les serpents sont intégrés dans ce mythe à la fois comme divinités météorologiques et comme totems à l'origine des migrations du clan.
Dans cette danse des serpents, l'animal n'est donc pas sacrifié : par des actes de consécration et des mimiques dansées qui agissent sur lui, on en fait un messager, afin qu'une fois retourné parmi les âmes des défunts il déclenche aussitôt, sous forme d'éclair, l'orage dans le ciel. Ce qui nous donne un aperçu de la manière dont mythe et pratique magique s'interpénétrent chez l'homme primitif.
[Sacrifices sanglants et sublimation dans la Grèce antique]
 Pour le spectateur, il semble évident que cette forme de défoulement qui caractérise la magie religieuse des Indiens est le trait le plus spécifique de la sauvagerie primitive, un trait totalement inconnu de l'Europe. Et pourtant, il y a deux mille ans, en Grèce, le pays d'origine de notre culture européenne, des rites étaient en train de naître, qui dépassent encore en horreur brutale ce que nous voyons chez les Indiens.
Pour le spectateur, il semble évident que cette forme de défoulement qui caractérise la magie religieuse des Indiens est le trait le plus spécifique de la sauvagerie primitive, un trait totalement inconnu de l'Europe. Et pourtant, il y a deux mille ans, en Grèce, le pays d'origine de notre culture européenne, des rites étaient en train de naître, qui dépassent encore en horreur brutale ce que nous voyons chez les Indiens.
Dans le culte orgiaque de Dionysos, par exemple, les ménades dansaient en tenant des serpents dans une main) et portaient autour de leur tête, comme un diadème, le serpent ondulant - tandis que dans l'autre main elles tenaient l'animal qui devait être déchiré au cours de la danse ascétique sacrificielle en l'honneur du dieu. Contrairement à ce qui advient dans les danses actuelles des Indiens mokis, le sacrifice sanglant dans le délire est l'apogée et le sens véritable de la danse religieuse.i-
S'affranchir du sacrifice sanglant est l'idéal de purification le plus profond qui traverse l'histoire de l'évolution religieuse de l'Orient à l'Occident. Le serpent est associé à ce processus de sublimation dans la religion. On peut voir dans l'évolution de sa fonction un indicateur de la métamorphose de la croyance fétichiste en pure religion du salut. Dans l'Ancien Testament, c'est le serpent originel Tiamat, à Babylone, qui incarne l'esprit du mal, de la séduction. En Grèce, il est aussi l'impitoyable dévoreur souterrain : l'Érinye est entourée de serpents tressaillants, et les dieux envoient le serpent lui-même comme un bourreau, pour appliquer la sentence. Cette idée du serpent comme figure destructrice surgie des enfers est devenue, dans le mythe de Laocoon comme dans le groupe sculpté qui le représente le symbole tragique le plus puissant. La vengeance des dieux, exécutée sur la personne de leur prêtre et de ses deux fils par le serpent qui les étrangle devint, dans ce célèbre groupe antique, l'incarnation évidente de la suprême souffrance humaine. Le prêtre-oracle, qui avait voulu par ses avertissements aider son peuple contre la ruse des Grecs, succombe à la vengeance des dieux partiaux. Ainsi la mort du père et de ses fils se change en symbole de la souffrance : la mort causée par la vengeance de démons, sans justice ni espoir de salut. Voilà le pessimisme tragique et désespéré de l'Antiquité.
On peut voir dans l'évolution de sa fonction un indicateur de la métamorphose de la croyance fétichiste en pure religion du salut. Dans l'Ancien Testament, c'est le serpent originel Tiamat, à Babylone, qui incarne l'esprit du mal, de la séduction. En Grèce, il est aussi l'impitoyable dévoreur souterrain : l'Érinye est entourée de serpents tressaillants, et les dieux envoient le serpent lui-même comme un bourreau, pour appliquer la sentence. Cette idée du serpent comme figure destructrice surgie des enfers est devenue, dans le mythe de Laocoon comme dans le groupe sculpté qui le représente le symbole tragique le plus puissant. La vengeance des dieux, exécutée sur la personne de leur prêtre et de ses deux fils par le serpent qui les étrangle devint, dans ce célèbre groupe antique, l'incarnation évidente de la suprême souffrance humaine. Le prêtre-oracle, qui avait voulu par ses avertissements aider son peuple contre la ruse des Grecs, succombe à la vengeance des dieux partiaux. Ainsi la mort du père et de ses fils se change en symbole de la souffrance : la mort causée par la vengeance de démons, sans justice ni espoir de salut. Voilà le pessimisme tragique et désespéré de l'Antiquité.
[Le serpent bienfaisant d'Asclépios]
À côté du serpent où l'Antiquité, dans son image pessimiste du monde, voit un démon, il existe un dieu-serpent antique dans lequel nous pouvons saluer enfin la lumineuse beauté de l'humanisme antique. Asclépios, le dieu antique de la guérison, a pour symbole le serpent qui s'enroule autour de son bâton guérisseur). Ses traits sont déjà ceux que porte dans la sculpture classique le Sauveur du monde
. Et ce dieu antique des âmes défuntes, le plus sublime et le plus radieux, a ses racines dans l'empire souterrain, où demeure le serpent vivant. C'est comme serpent qu'on lui rend le culte le plus ancien. Ce qui s'enroule autour de son bâton, c'est lui-même, c'est-à-dire l'âme défunte du mort qui se perpétue et reparaît sous la forme du serpent. Car le serpent n'est pas seulement, comme diraient les Indiens de Cushing, « une morsure mortelle infligée ou prête à bondir », qui détruit impitoyablement : au moment de la mue, il démontre sur lui-même comment un corps a pu quitter sa peau et comment — en se glissant en quelque sorte hors de son enveloppe mortelle - il a pu renaître et se perpétuer. Il peut se couler dans le sol et en ressortir1. Le fait de ressurgir de la terre où reposent les morts - s'ajoutant à cette capacité de renouveler son enveloppe — fait du serpent le symbole le plus naturel de l'immortalité et de la renaissance après la détresse de la maladie et de la mort.
Dans le sanctuaire d'Asclépios à Cos, en Asie Mineure, le dieu apparaissait sous forme de statue, comme un être humain transfiguré, tenant à la main le bâton autour duquel s'enroule le serpent. Pourtant ce n'était pas dans un masque de pierre sans vie que son essence la plus spécifique et la plus puissante était présente dans ce sanctuaire : il survivait sous la forme d'un serpent vivant au plus profond de ce lieu. Dans les offices du culte on le nourrissait, on le soignait, on le traitait comme seuls les Mokis peuvent soigner les serpents.
Sur une page de calendrier espagnol du XIIIe siècle que j'ai trouvée dans un manuscrit de la bibliothèque Vaticane et qui donne une image d'Asclépios gouvernant le mois correspondant au signe du Scorpion, on retrouve l'expression très claire de ces tentatives d'approche1 à la fois grossières et raffinées du culte du serpent d'Asclépios. Dans trente sections consacrées au culte de Cos, nous voyons, esquissées sous forme d'hiéroglyphes, des actions rituelles identiques aux tentatives magiques et directes des indiens.
[Une causalité dansée]
Je m'estimerai heureux si ces images de la vie quotidienne et [des pratiques] cérémoniales des Indiens pueblos vous ont montré que leurs danses des masques ne sont pas un jeu mais une réponse, sous une forme primaire païenne, à la grande et douloureuse question du pourquoi des choses : au caractère incompréhensible des phénomènes naturels, l'Indien oppose sa volonté de comprendre en se transformant personnellement, en devenant lui-même cette cause des choses. Instinctivement, il se constitue en cause de l'enchaînement inexpliqué, qu'il rend aussi compréhensible et aussi visible que possible. La danse des masques est une causalité dansée.
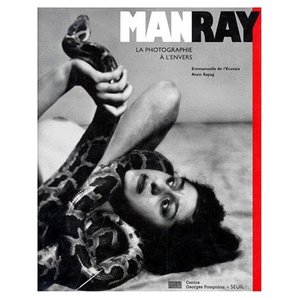 Si la religion est connexion [le symptôme de l'évolution par laquelle on quitte cet état originel se reconnaît à ceci : la connexion entre l'homme et l'entité étrangère tend à devenir spirituelle du fait qu'il n'y a plus d'amalgame entre le symbole du masque et l'homme lui-même, qui met en œuvre la causalité en pensée uniquement, progressant vers une mythologie systématique fondée sur le langage. La volonté de s'absorber dans la dévotion est une forme sublimée de l'action de se masquer. Avec ce que nous nommons progrès de la civilisation, l'objet de dévotion perd toujours davantage sa matérialité monstrueuse pour devenir à la fin un symbole spirituel invisible.
Si la religion est connexion [le symptôme de l'évolution par laquelle on quitte cet état originel se reconnaît à ceci : la connexion entre l'homme et l'entité étrangère tend à devenir spirituelle du fait qu'il n'y a plus d'amalgame entre le symbole du masque et l'homme lui-même, qui met en œuvre la causalité en pensée uniquement, progressant vers une mythologie systématique fondée sur le langage. La volonté de s'absorber dans la dévotion est une forme sublimée de l'action de se masquer. Avec ce que nous nommons progrès de la civilisation, l'objet de dévotion perd toujours davantage sa matérialité monstrueuse pour devenir à la fin un symbole spirituel invisible.
Ce qui signifie la chose suivante : le domaine de la mythologie n'est pas régi par la loi de l'énergie minimale, on ne cherche pas le facteur déclenchant le plus discret de la rationalité. Au contraire : pour rendre les choses  saisissables, on institue un être saturé d'énergie démonique, afin de pouvoir véritablement saisir à pleines mains la cause des événements mystérieux. Ce que nous avons vu ce soir du symbolisme du serpent, certes trop rapidement et trop sommairement, doit nous montrer comment un symbolisme incarné dans le réel, qui s'approprie les choses en les prenant en main, devient un symbolisme qui s'inscrit dans l'ordre de la pensée. Les Indiens saisissent vraiment le serpent à pleines mains et se l'approprient vivant, comme cause et comme substitut de
saisissables, on institue un être saturé d'énergie démonique, afin de pouvoir véritablement saisir à pleines mains la cause des événements mystérieux. Ce que nous avons vu ce soir du symbolisme du serpent, certes trop rapidement et trop sommairement, doit nous montrer comment un symbolisme incarné dans le réel, qui s'approprie les choses en les prenant en main, devient un symbolisme qui s'inscrit dans l'ordre de la pensée. Les Indiens saisissent vraiment le serpent à pleines mains et se l'approprient vivant, comme cause et comme substitut de
L’éclair. L’indien le place dans sa bouche, de sorte q’une véritable union a lieu entre le serpent et l’homme masqué ou orné de peintures de serpents.
La relation de l'homme en quête de salut avec le serpent évolue, dans le cycle de l'adoration cultuelle, depuis l'approche sensorielle la plus fruste jusqu'au dépassement. Comme nous le voyons dans les cultes des Indiens pueblos, c'était - et c'est encore - un critère judicieux de cette évolution qui va de l'approche instinctive et magique à l'établissement d'une distance intellectualisante. Le serpent  venimeux symbolise les forces naturelles démoniques que l'homme doit surmonter extérieurement et intérieurement. Ce soir, je n'ai pu vous présenter qu'une véritable survivance du culte magique du serpent - malheureusement beaucoup trop rapidement - pour vous montrer son état originel, que la culture moderne travaille à affiner, à dépasser et à remplacer.
venimeux symbolise les forces naturelles démoniques que l'homme doit surmonter extérieurement et intérieurement. Ce soir, je n'ai pu vous présenter qu'une véritable survivance du culte magique du serpent - malheureusement beaucoup trop rapidement - pour vous montrer son état originel, que la culture moderne travaille à affiner, à dépasser et à remplacer.
Dans une rue de San Francisco, j'ai pu prendre un instantané de l'homme qui a triomphé du culte du serpent et de la peur de l'éclair, l'héritier des habitants primitifs et du chercheur d'or qui a éliminé l'Indien. C'est l'oncle Sam, coiffé d'un haut-de-forme, marchant fièrement dans la rue et passant devant un édifice circulaire néo-classique1. Un câble électrique est tendu au-dessus de son chapeau). Dans ce serpent de cuivre d'Edison, il a dérobé l'éclair à la nature.
Le serpent à sonnettes n'épouvante plus l'Américain d'aujourd'hui. On le tue, on ne lui voue plus de culte comme à une divinité. Ce qu'on lui oppose, c'est l'extermination. L'éclair prisonnier dans un fil, l'électricité domestiquée ont produit une civilisation qui rompait avec le paganisme. Qu'ont-ils produit à la place ? Les forces de la nature ne sont plus conçues comme des configurations anthropomorphes ou bio-morphes, mais comme une succession d'ondes interminables, qui obéissent à l'injonction manuelle de l'homme. Ainsi la civilisation de l'âge mécanique détruit-elle ce que la connaissance de la nature, née du mythe, avait péniblement construit, l'espace de contemplation qui est devenu l'espace de pensée
L'éclair prisonnier dans un fil, l'électricité domestiquée ont produit une civilisation qui rompait avec le paganisme. Qu'ont-ils produit à la place ? Les forces de la nature ne sont plus conçues comme des configurations anthropomorphes ou bio-morphes, mais comme une succession d'ondes interminables, qui obéissent à l'injonction manuelle de l'homme. Ainsi la civilisation de l'âge mécanique détruit-elle ce que la connaissance de la nature, née du mythe, avait péniblement construit, l'espace de contemplation qui est devenu l'espace de pensée
Le moderne Prométhée et le moderne Icare, Franklin et les frères Wright, qui ont inventé le ballon dirigeable, sont les destructeurs fatidiques de la notion de distance, destruction qui menace de reconduire la planète au chaos.
Le télégramme et le téléphone détruisent le cosmos. La pensée mythique et la pensée symbolique, en luttant pour donner une dimension spirituelle à la relation de l'homme à son environnement, ont fait de l'espace une zone de contemplation ou de pensée, espace que la communication électrique instantanée anéantit. »






OUi, bien quand je lis ça, je trouve que l'homme tribal est aussi con que l'homme moderne. Faire souffrir des animaux pour un rituel quel qu'il soit c'est faire preuve d'un manque total de compassion pour la souffrance de l'autre. Donc d'une méconnaissance de la vie et d'un égoisme désespérant.
Ca n'enlève rien à la qualité de votre présentation bien sûr.
Rédigé par : Caty | mardi 16 oct 2007 à 06h53