Quand tisonner les mots pour un peu de couleur
ne sera plus ton affaire
quand le rouge du sorbier et la cambrure des filles
ne te feront plus regretter ta jeunesse
quand un nouveau visage tout écorné d'absence
ne fera plus trembler ce que tu croyais solide
et l'oubli dit adieu à l'oubli
quand tout aura revêtu la silencieuse opacité du
houx
ce jour-là
quelqu'un t'attendra au bord du chemin
pour te dire que c'était bien ainsi
que tu devais terminer ton voyage
démuni
love songs
 Nicolas Bouvier est né en 1929 à Genève, où il meurt en 1998. Enfant, il est immergé dans les livres. Grâce à un père bibliothécaire, il lit, dès l'âge de sept ans, tout Jules Verne, Curwood, Stevenson, London et Fenimore Cooper. Il dira lui-même : " À huit ans, [il traçait] avec l'ongle de [son] pouce le cours du Yukon dans le beurre de [sa] tartine. Déjà, l'attente du monde : grandir et déguerpir ".
Nicolas Bouvier est né en 1929 à Genève, où il meurt en 1998. Enfant, il est immergé dans les livres. Grâce à un père bibliothécaire, il lit, dès l'âge de sept ans, tout Jules Verne, Curwood, Stevenson, London et Fenimore Cooper. Il dira lui-même : " À huit ans, [il traçait] avec l'ongle de [son] pouce le cours du Yukon dans le beurre de [sa] tartine. Déjà, l'attente du monde : grandir et déguerpir ".
Au choix d'une carrière universitaire, Bouvier oppose celui des grands chemins. Les premières fois que j'ai voulu partir, je n'ai même pas eu à fuguer : mon père m'y a poussé. Lui n'ayant pas pu voyager autant qu'il le souhaitait l'a ainsi fait par procuration.
Un de ses plus grands voyages, il le fera accompagné du dessinateur Thierry Vernet. Ils partent pour la Yougoslavie et suivent la route des Tziganes pour débouler à Kaboul. De ce voyage naîtra L'Usage du monde, récit de voyage polyphonique, livre culte des écrivains voyageurs. Puis il poursuivra sa route, avec pour mot d'ordre : cap à l'Est ! De la Laponie à l'Anatolie, du Tibet au Japon, de l'Irlande à la Corée… le livre transcrit un sens du monde puisé dans la rencontre et l'échange, dans l'émerveillement toujours recommencé de la route à faire. La découverte de paysages et de cultures différentes, sera vécue dans l'idée d'un nécessaire dépouillement physique et intellectuel, d'un abandon progressif de ce qui a été appris .Nicolas Bouvier aimait citer : " toute une vie ne suffit pas pour désapprendre, ce que naïf, soumis, tu t'es laissé mettre dans la tête - innocent ! - sans songer aux conséquences "
Il sera tour à tour poète, photographe, iconographe, homme de radio et de télévision, guide touristique en Chine (pour une petite agence de voyages culturels) et professeur.
Pour Nicolas Bouvier " un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait ". Ou encore : " on ne voyage pas pour se garnir d'exotisme et d'anecdotes comme un sapin de Noël, mais pour que la route vous plume, vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes élimées par les lessives qu'on vous tend avec un éclat de savon dans les bordels "
Cette manière de vivre, aux antipodes du tourisme actuel a été la garantie d'une authentique découverte de la culture des autres. Son intelligence du monde est celle du flâneur et du nomade et pour lui le reflet permanent de sa propre réalité, le miroir dans lequel il pouvait observer sa propre identité culturelle. Filtrée par le temps, tamisée par la mémoire, décantée par l'écriture, dynamisée par l'imagination, son expérience est devenue un récit existentiel, plus proche d'une philosophie de la vie que de la stricte littérature de voyage.
Portant sur le monde un regard très aigu ,Nicolas Bouvier n'a pas tardé à découvrir la photographie, Elle l'encouragea à exercer sa passion des détails et des fragments, à mettre en valeur les objets les plus humbles, qui retrouvaient ainsi une pleine existence, elle lui permit de garder trace de la fulgurance des émotions ou de la simple beauté des visages. Ce trait typiquement photographique deviendra même une constante de son style littéraire, et il gardera, au-delà ce de qui fut toujours pour lui un long et douloureux travail des mots, la vivacité des découvertes au jour le jour. . Pour lui, la photographie est une " autre façon de raconter ", beaucoup plus directe. C'est en fait une autre approche, une autre lecture, presque un autre projet, même si les interactions sont permanentes.
L'écriture montre l'unité du monde telle que Nicolas Bouvier la pense, alors que la photographie en révèle la diversité telle qu'il l'a vécue.
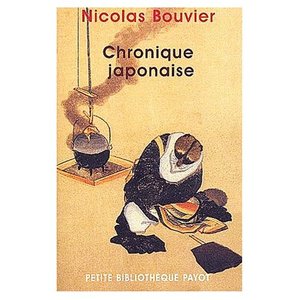 Chroniqueur de l'image, voyageur qui écrit, Nicolas Bouvier a photographié, et il est devenu plus tard iconographe, c'est-à-dire " chercheur d'images " pour des éditeurs, une démarche qui l'a conduit à réfléchir aux sens de celles-ci et à la diversité de leurs usages.
Chroniqueur de l'image, voyageur qui écrit, Nicolas Bouvier a photographié, et il est devenu plus tard iconographe, c'est-à-dire " chercheur d'images " pour des éditeurs, une démarche qui l'a conduit à réfléchir aux sens de celles-ci et à la diversité de leurs usages.
« J'ai donc, écrit Bouvier, passé des heures de félicité absolue, à découvrir cet immense archipel des images qui m'a autant cultivé que les études ou les voyages que j'ai pu faire ou ferai peut-être encore. Sans compter le plaisir presque gustatif que c'est que de cadrer, photographier, tirer soi-même, dans le silence de la chambre noire, les documents qu'on a dénichés"
La vie ne m'a pas fait attendre, elle a toujours, ou presque, roulé plus vite que moi. J'ai couru derrière, j'ai couru vite et longtemps, mais c'est trop rarement que je l'ai rattrapée. L'unique chose que j'attends d'elle aujourd'hui: un peu de légèreté et de liberté intérieure, je sais déjà que, dans ce monde trompeur, je n'en aurai que quelques grammes, alors que j'en voulais par kilos. Je continue de courir, de plus en plus lentement, et savoir jusqu'à quand n'est, hélas, pas de mon ressort.
C'est à cette poursuite que j'ai consacré le plus clair de mon existence; c'est elle qui m'a mis sur les routes.
Cette impatience du monde a commencé au début des années trente par d'immenses lectures enfantines. Mon père était bibliothécaire, et ma mère, la plus piètre cuisinière à I'ouest de Suez. C'est dire que dans ma maison, le coupe-papier comptait plus que le couteau à pain. C'est dire aussi qu'une indifférence quasi totale à la gastronomie a fait de moi un voyageur très endurant. L’echappée belle
· L'Usage du monde, Payot 2001.
· Japon, Rencontre 1967.
· Chronique japonaise, Payot 2001.
· Le Poisson-scorpion, Folio 1996.
· Le Dehors et le dedans, Zoé 1998.
· Boissonnas. Une dynastie de photographes, Payot Lausanne 1999
· Journal d'Aran et d'autres lieux, Payot 2001.
· L'Art populaire en Suisse, Zoé 1991.
· La Vie immédiate, Payot 1991.
· Routes et déroutes. Entretiens avec Irène Lihtenstein-Fall, Métropolis 1997.
· Le Hibou et la baleine, Zoé 1998.
· Les Chemins du Halla San, MiniZoé 1998.
· L'Echappée belle. Eloge de quelques pérégrins, Métropolis 1997.
· Une orchidée que l'on appela vanille, Métropolis 1998.
· Entre Errance et éternité. Regards sur les montagnes du monde, Zoé 1998.
· L'œil du voyageur, Hoebeke 2001.
. Bouvier pratique le globe comme un exercice spirituel : " Il m'a paru bien vite (…) que la terre (…) nous était donnée comme une vaste merveille à déchiffrer. Avec trois clés reçues dans mon berceau : la lecture, le voyage et l'écriture ".
Bouvier pratique le globe comme un exercice spirituel : " Il m'a paru bien vite (…) que la terre (…) nous était donnée comme une vaste merveille à déchiffrer. Avec trois clés reçues dans mon berceau : la lecture, le voyage et l'écriture ".
Son œuvre en dix livres a vu le jour après s’être décantée de longues années, il a forgé ses livres dans la plus grande intimité, en les frottant au réel mouvant qu'est le monde. Pour lui, l'écriture est toujours une longue patience. Il lui faut attendre que les souvenirs décantent, regrouper ce qui était éparpillé,. " Longue patience, recherche et attente du mot juste qui rendrait aux rencontres, aux voix, aux paysages, aux routes leur fraîcheur native et les contours précis qu'on avait perçus. "
C'est qu'il souhaite laisser la place à tous les hasards, car " un voyage est fait de quelques décisions que nous prenons et de beaucoup qu'on nous impose. Ces dernières sont souvent les meilleures. " Ainsi, lors de son séjour en Azerbaïdjan, la neige bloque son avancée vers l'Est. Finalement, il garde de ce séjour un souvenir inoubliable, résumant cette expérience par ces mots : " C'est ce que j'appelle la dérive ".
Alors qu'en Occident, l'abandon aux choses est considéré comme une attitude passive, en Asie, il s'agit de suivre et d'épouser le courant vital. De même le voyage, considéré comme marginal en Occident, prend une valeur noble en Asie. " La dialectique de la vie nomade est faite de deux temps : s'attacher et s'arracher. On n'arrête pas de vivre ce couple de mots tout au long de la route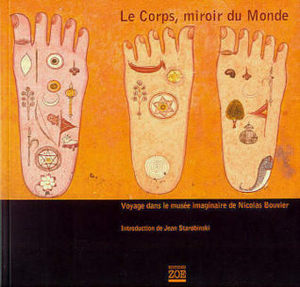
textes :extraits de routes et déroutes
Sur l’usage du monde :
J'étais parti pour rencontrer des gens et ce livre est une gigantesque ménagerie, où un singe observe un cheval, un cheval observe un mollah, qui observe une fourmi, et ces constats éberlués donnent lieu à des réflexions assez cocasses. Les gens nous enviaient beaucoup de mener cette vie parce que le statut nomade en Asie est souvent relié à des pèlerinages religieux. Voyager est considéré comme un projet extrêmement respectable. D'ailleurs, les différents mots qu'on utilise pour route, voyage, voyageur en pachtoun, en urdu, en farsi, sont des mots nobles. Alors, ou nous avions affaire à des coupe-jarrets, et comme il n'y avait pas grand-chose à voler ils ne nous volaient pas, ou nous nous arrangions avec eux parce que nous avions le temps - les plus dangereux étaient des flics un peu trop laissés à eux-mêmes -, ou nous avions affaire à des gens qui nous faisaient aussitôt entrer chez eux et nous donnaient ce qu'ils avaient de meilleur. C'était un geste symbolique, une sorte d'hommage à la route, très impressionnant. Et je suis bien content de l'avoir faite à un moment où elle était encore vide.
Comme je l'ai dit, s'il y a eu cet axe vers l'Est, c'est que j'avais le sentiment d'une destinée historique, l'impression que l'Asie était la mère de l'Europe, une mère humiliée par les massacres et les guerres coloniales, que Pestelli appelle dans un très beau texte «une mère courbée». Pour moi, il y avait la grand-mère, qui était l'Asie, la mère, l'Europe et la fille, l'Amérique. Je trouvais plus naturel d'aller d'abord chez les vieux. Et ce n'est qu'il y a quelques années que je suis parti vers l'Ouest et que j'ai découvert l'Irlande, l'Ecosse, les États-Unis. Sur ces deux dernières années, j'ai presque passé un an aux États-Unis, avec d'immenses satisfactions, aussi parce que j'étais plus fort de cette connaissance de l'Asie. Il y a une chronologie de la connaissance et il faut commencer par le plus ancien, sans bien sûr dédaigner ce qui est plus récent, ce qui est ancien n'ayant à mon sens aucune supériorité intrinsèque ou de droit sur ce qui l'est moins. Sinon, au lieu de lire des livres sur Brahms ou sur Schubert, on en lirait sur le papa de Brahms et la maman de Schubert.
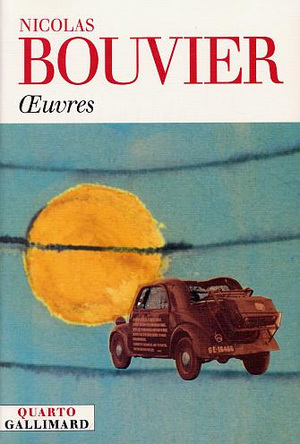 J'ai eu en Amérique des chocs culturels comparables dans le plaisir avec ceux que j'ai éprouvés en Asie, mais pas dans l'acquisition des connaissances. C'était la nature, cette géographie brute qui m'ont émerveillé. En Asie, la densité historique est saisissante. Même dans le paysage le plus sauvage du Takla-Makan, il y a mille ans, deux ou trois pèlerins sont passés avec leurs sandales de paille et ont consigné leur itinéraire dans des textes aussi rudes que la nature qu'ils affrontaient et, il y a cinq cents ans, une princesse mongole avec ses ballots de fourrure. Dans un endroit où on ne voit personne sur des lieues et des lieues, il y a toujours un petit tumulus, un tombeau de marabout qui est là pour le rappeler, ou une inscription.
J'ai eu en Amérique des chocs culturels comparables dans le plaisir avec ceux que j'ai éprouvés en Asie, mais pas dans l'acquisition des connaissances. C'était la nature, cette géographie brute qui m'ont émerveillé. En Asie, la densité historique est saisissante. Même dans le paysage le plus sauvage du Takla-Makan, il y a mille ans, deux ou trois pèlerins sont passés avec leurs sandales de paille et ont consigné leur itinéraire dans des textes aussi rudes que la nature qu'ils affrontaient et, il y a cinq cents ans, une princesse mongole avec ses ballots de fourrure. Dans un endroit où on ne voit personne sur des lieues et des lieues, il y a toujours un petit tumulus, un tombeau de marabout qui est là pour le rappeler, ou une inscription.
Quand vous arrivez à Dunhuang, au cœur des déserts du Ransu, où vous avez d'immenses falaises, où des dizaines de milliers de moines ont taillé des cellules dans la roche comme une ruche d'abeilles et les ont garnies de superbes peintures, vous êtes impressionné. Vous êtes devant une sorte de cathédrale culturelle. Il n'y a pas que la peinture, il y a les textes, la musique. Quand vous êtes à Xian, dans la forêt des stèles, vous avez trois ou quatre mille ans d'Histoire et d'Histoire qu'on peut encore vivre aujourd'hui. Ce n'est pas quarante ans de puritanisme maoïste et d'index levé qui font disparaître une culture aussi bien ancrée dans le temps.
Après avoir franchi un col himalayen - ce qui ne m'est pas encore arrivé mais j'espère le faire bientôt - entre le Cachemire et la Chine, j'adorerais trouver le récit de cette pérégrination chez un bonze du vme siècle, écrit dans le superbe chinois de l'époque T'ang et mis ensuite à notre portée par des sinologues anglais ou français. J'aime les traces écrites. Elles m'émeuvent profondément.
Aux États-Unis, ce qu'ils appellent monuments historiques, conseillés par d'importants écriteaux bruns, c'est par exemple un pan de mur de moulin qui a soixante-cinq ans.
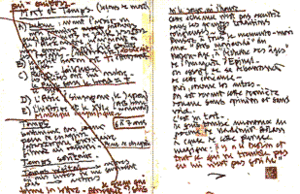 Et lorsque par récriture vous restituez ces situations extrêmes et que le miroir que vous promenez le long des routes (pour reprendre une citation de Stendhal qui vous est chère) se retourne vers vous?
Et lorsque par récriture vous restituez ces situations extrêmes et que le miroir que vous promenez le long des routes (pour reprendre une citation de Stendhal qui vous est chère) se retourne vers vous?
J'ai passé par ces moments terriblement difficiles qui vous renvoient à vous-même avec brutalité, comme un poignard qui tout à coup se retourne contre celui qui le tient. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'on n'est rien. Que l'ego n'est rien, que ce dont on se faisait fort à disparu : il n'y a plus rien. Et faire l'expérience de ce rien est une chose très nécessaire sur le chemin de la vie. Il faut la faire au moins une fois. Sinon, on continue à se pavaner comme un dandy jusqu'à la tombe, ce qui est grotesque.
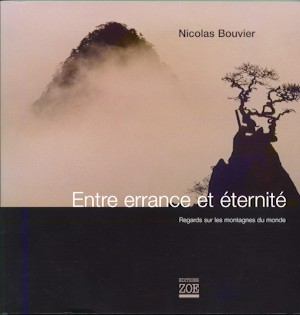 Dans la géographie, il y a des pièges et quand on les sent il faut s'en aller. À deux reprises il m'est arrivé de déguerpir sans raison valable, sans menace objective perceptible, parce que je sentais de très mauvaises ondes telluriques. J'ai pris mes jambes à mon cou. Chose intéressante, une fois ça m'est arrivé alors que j'étais encore en compagnie de Thierry Vernet. C'était au sud d'Ispahan, à la tombée du jour, alors que le paysage était magnifique, mais tout à coup, sans nous consulter, tous les deux nous avons senti qu'il fallait décamper. Une autre fois, j'étais allé dans la banlieue de Nagoya, voir un peintre belge dont le travail ne m'intéressait pas du tout, mais comme j'étais un peu esseulé, discuter avec un Européen, boire du Bols, faisait du bien. Et là il y avait un modèle japonais à poil, un peu crado, et je sentais bien que ce Belge venait de la saillir. L'atmosphère était gluante. Je l'ai quitté et je me suis dit: je vais aller me promener. H y avait un terrain vague encore complètement troué par des cratères de bombes qui, comme c'était la mousson de juin, étaient tous remplis d'eau saumâtre. Une fille faisait du motocross, nue jusqu'au ventre, avec une énorme ceinture cloutée, des bottes cloutées et, comme un méchant petit génie, franchissait ces flaques à moto. Je me suis dit, si je regarde cette Dourga en face, je vais disparaître.
Dans la géographie, il y a des pièges et quand on les sent il faut s'en aller. À deux reprises il m'est arrivé de déguerpir sans raison valable, sans menace objective perceptible, parce que je sentais de très mauvaises ondes telluriques. J'ai pris mes jambes à mon cou. Chose intéressante, une fois ça m'est arrivé alors que j'étais encore en compagnie de Thierry Vernet. C'était au sud d'Ispahan, à la tombée du jour, alors que le paysage était magnifique, mais tout à coup, sans nous consulter, tous les deux nous avons senti qu'il fallait décamper. Une autre fois, j'étais allé dans la banlieue de Nagoya, voir un peintre belge dont le travail ne m'intéressait pas du tout, mais comme j'étais un peu esseulé, discuter avec un Européen, boire du Bols, faisait du bien. Et là il y avait un modèle japonais à poil, un peu crado, et je sentais bien que ce Belge venait de la saillir. L'atmosphère était gluante. Je l'ai quitté et je me suis dit: je vais aller me promener. H y avait un terrain vague encore complètement troué par des cratères de bombes qui, comme c'était la mousson de juin, étaient tous remplis d'eau saumâtre. Une fille faisait du motocross, nue jusqu'au ventre, avec une énorme ceinture cloutée, des bottes cloutées et, comme un méchant petit génie, franchissait ces flaques à moto. Je me suis dit, si je regarde cette Dourga en face, je vais disparaître.
J'ai filé sans demander mon reste.
 Il ne faut pas du tout ignorer les messages de l'instinct. Je suis convaincu que nous n'utilisons qu'un dixième des facultés de notre cerveau et ce qu'il y a de bien en voyage, c'est qu'il vous oblige à jouer tous vos atouts et à les jouer bien.
Il ne faut pas du tout ignorer les messages de l'instinct. Je suis convaincu que nous n'utilisons qu'un dixième des facultés de notre cerveau et ce qu'il y a de bien en voyage, c'est qu'il vous oblige à jouer tous vos atouts et à les jouer bien.
Je fais une grande confiance à la fatigue, et ce que je reproche aujourd'hui à mon corps, c'est de ne plus être capable de me fatiguer jusqu'au bout, jusqu'aux moments d'épuisement total qui peuvent se produire après une très longue marche. Maintenant, je vais à petits pas parce que mes limites physiques se sont rétrécies. La marche est aussi un processus de connaissance et d'illumination. D'une part à cause de son rythme, d'autre part parce que, comme il faut vraiment se concentrer sur la façon de poser les pieds, sur où on les met, sur comment ménager son souffle, ça occupe la totalité de l'esprit. Quelquefois, au bout de très longues marches, non pas au but, mais en vue du but, lorsque vous savez que vous l'atteindrez, se produit une sorte d'irruption du monde dans votre mince carcasse, fantastique, dont on ne parvient pas à rendre compte avec les mots.
«Et pourquoi s'obstiner à parler de ce voyage? quel rapport avec ma vie présente? aucun, et je n'ai plus de présent. Les pages s'amoncellent, j'écorne un peu d'argent qu'on m'a donné, je suis presque un mort pour ma femme qui est bien bonne de n'avoir pas encore mis la clé sous la porte.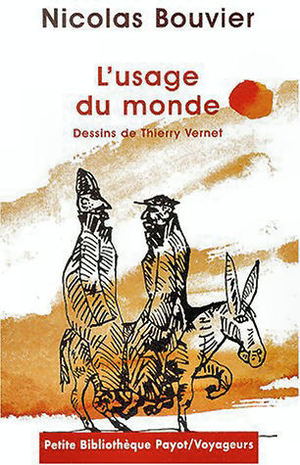
C'est l'enfer de l'écrivain. Vous n'y coupez pas : c'est le prix, ce que j'appelle ailleurs la livre de chair de Shylock. On ne peut payer un texte juste qu'avec du sang et on n'en a que quatre litres et demi. C'est pourquoi, lorsque j'en ai terminé un, grand ou petit, je ne peux jamais savoir si ce ne sera pas le dernier. Ça me paraît inconcevable de me remettre de suite à cette varappe désespérante, où finalement mes seules armes sont mes insuffisances. Mais quand on a vraiment tiré sur la corde jusqu'à s'en blesser les mains, il y a des moments où, par extrême fatigue, les choses auxquelles on pensait font littéralement irruption. Elles vous traversent avec leurs couleurs. Là, on écrit à toute allure et on sait que chaque mot est juste. Mais ça, c'est donné. C'est dans la nature des choses que cette perception du monde s'obtienne d'ordinaire au prix d'un énorme travail. Quelquefois, il y a des moments bénis - trop rares - où on est envahi sans avoir fait cette ascèse préparatoire. L'écriture est pour moi un exercice extrêmement ascétique, même si je me soutiens parfois avec des dopants comme l'alcool ou des comprimés qui désinhibent, J'ai grandi dans un milieu dont le moralisme exige la précision des sentiments. Il ne faut pas être flou, il faut que les choses soient monolithiques et tranchées, souvent de façon manichéenne. Or, la littérature s'accommode très mal des bons sentiments et du souci moraliste. Pierre-Olivier Walzer, dans une admirable préface de La Fourmi rouge de Charles-Albert Cingria, a bien exprimé ça. Il faut voir la stérilité d'un homme comme Amiel. Son Journal est un long cri d'ennui.
À l'époque de cet extrait, tout le monde autour de moi me reprochait ma stérilité, ma lenteur, mon perfectionnisme. On me disait: « C'est ridicule, un récit de voyage, ça se raconte comme une course d'école



enchantée de lire ce post sur Nicolas Bouvier,que je révère,lis et relis.
Avez vous lu Charles-Albert Cingria?
Catherine
Rédigé par : catherine willis | samedi 12 juil 2008 à 13h05