L'intervention de logiques techniciennes nouvelles, l'exemple de la Datar, comme le souligne A. Richard reviennent désormais à « questionner la définition « classique » et encore couramment utilisée, du paysage : le paysage comme vue. , un spectacle visuel obtenue depuis une hauteur, comme un panorama.cette prise par la vue suppose une distance, un recul une contemplation c'est grâce à cette prise de distance que le paysage pourrait apparaître devant les yeux du spectateur, du voyageur, du touriste. Le paysage se présenterait alors au regard comme une sorte de petit monde synthétique et complet.(cf le jardin ou l'espace du tableau)) cette définition est aujourd'hui critiquée. Non pas que cette conception soit fausse, mais elle s'avère désormais insuffisante, autrement dit parce qu'elle ne rendrait pas compte de la complexité et de la diversité des
expériences paysagères, des expériences qui ne sont pas toutes, et en tout cas qui ne sont pas uniquement, de l'ordre de la vision et de la prise de distance.
. « Reste à savoir s'il ne s'agit que d'un vœu pieux, ou s'il nous est possible de déceler les signes avant-coureurs d'une modélisation prochaine, bref, si nous sommes en mesure de prévoir l'avenir. Je ne m'y hasarderai pas et me contenterai, modestement, de rassembler quelques indices, de relever quelques traces, de suivre quelques pistes.
La première est celle qu'a ouverte Francastel, voilà plus de quarante ans. À la place de l'espace euclidien, il voyait chez les peintres (d'où les limites de sa prospective) la gestation de nouveaux espaces, au demeurant hétérogènes : espaces-courbes, espaces-forces, espaces polysensoriels, etc. « Notre époque s'efforce d'acquérir une sorte d'expérience directe des forces de la nature. On cesse de considérer que l'univers soit fait pour l'homme-roi, à son image, et que la figure de la terre soit, par hypothèse, la figure du monde. On abandonne l'idée que l'univers est l'agrandissement à l'infini du cube scénographique au centre duquel se déplace
l'homme-acteur. La figuration de l'espace cesse d'être une description pittoresque et décorative pour devenir un enregistrement de gestes ou d'actions élémentaires et de sensations éprouvées sur le plan de la conscience, en fonction de l'accord des différents sens. [...] Qui ne voit que nous sommes tout près de parvenir à exprimer des sensations familières à l'homme qui vole, à l'homme qui fait surgir jusqu'au contact de la raison les jeux complexes de son inconscient ? Figuration spatiale moderne, figuration spatiale fondée sur l'analyse de réflexes, figuration psycho-physiologique et non plus optique au sens euclidien du terme '. » Cette analyse me paraît tout à fait transposable à celle du paysage. L'invasion de l'audiovisuel, l'accélération des vitesses, les conquêtes spatiale et abyssale nous ont appris et obligés à vivre en de nouveaux paysages, souterrains, sous-marins, aériens : on trouve déjà de belles pages, chez Nadar, sur l'ivresse de la « photographie aérostatique » ; des paysages plus dynamiques : Proust, voilà près d'un siècle, découvrait [inventait...] le paysage « en voiture » ; des paysages sonores (les soundscapes de Murray-Schafer et les créations de Jean-François Augoyard) ; olfactifs (Nathalie Poiret), et bien d'autres registres, encore inexplorés, sinon insoupçonnés ; des paysages plus agressifs aussi, que le cinéma nous impose, à l'opposé du mythe arcadien, chère à la vieille Europe.
La seconde piste est celle du palimpseste. Je suis frappé par la récurrence de ce thème aujourd'hui. François Dagognet le développait naguère au centre Georges-Pompidou. Michel Conan fait, à son tour, « l'éloge du palimpseste », qu'il oppose au « panoramique », mis en place par la Renaissance : « Les formes modernes d'appréciation du paysage font une part croissante à cette exploration de la nature construite ou plus ou moins cultivée en l'abordant comme un palimpseste surchargé d'écritures multiples.» Et c'est, de nouveau, cette idée que l'on retrouve chez Bernard Lassus, celle d'un « paysage mille-feuilles », détenant mille couches et mille profondeurs, optiques, haptiques, kinesthésiques, cœnesthésiques, mémorisées, imaginaires, etc. probable que notre époque ouvre l'âge d'une exploration polysensorielle du monde. »Alain Richard.op.cité
On parle ainsi de nos jours de « paysage sonore » pour désigner « ce qui dans l'environnement sonore est perceptible comme unité esthétique » le compositeur canadien Murray Schafer bâtit ainsi le projet de paysage sonore mondial,( Le paysage sonore,) en montrant comment le monde naturel est générateur de sonorités identifiables (la pluie, les animaux, la neige) et caractéristiques des lieux d'où ils s'élèvent. Et de même pour le monde humain, notamment urbain (les voix, les machines, la résonance des sols), dont les sonorités se sont modifiées dans l'histoire en relation avec les transformations de la vie sociale, urbaine, économique. Les lieux et les espaces ne sont pas seulement visibles, ils sont audibles également. Ils dégagent des sonorités particulières qui d'une certaine manière « font paysage », au sens où ces sonorités constituent l'atmosphère ou l'ambiance caractéristiques de ces lieux.
On en vient également à possible de parler d'une sorte d'organisation olfactive de l'espace dans les paysages naturels et urbains. Cette géographie olfactive, sensible, a été bien étudiée par Alain Corbin, encore une fois, dans un ouvrage intitulé Le miasme et la jonquille, lequel retrace retracé l'histoire moderne de la « désodorisation » du monde, et plus précisément de l'espace public. A partir de 1750, les hommes d'occident ont peu à peu cessé de tolérer la proximité de l'excrément ou de l'ordure, et d'apprécier les lourdes senteurs du musc. Une sensibilité nouvelle apparaît, qui poussera les élites, affolées par les émanations sociales de la ville malade, à chercher dans les parcs et sur les flancs des montagnes la pureté de l'atmosphère : elles y rencontrent la jonquille, au parfum quasi imperceptible, qui, leur parlant de leur moi, révèle l'harmonie de leur être du monde. Je prétends que l'acte décisif s'est joué à partir du milieu du XVIII, a tout d'abord concerné le langage. Le français classique a été épuré, lavé de son vocabulaire nauséabond [afin] de le rendre imputrescible". De là apparaissent des unités linguistiques (grammaire, sons) pour désigner le sentir et l'excrément. Concernant la désodorisation A. Corbin partage la seconde perspective et date la révolution olfactive entre 1760 et 1840, période pendant laquelle "l'hygiéniste est promu au rang des héros qui traque les plus tenaces des répugnances". Ils préparent "l'ode immense à la propreté » chantée par le XIXème siècle."
Les paysages que chante Julien GRACQ ont cette qualité olfactive et sonore :le corps apparait aussi impliqué dans un paysage obstacle qui rend la marche difficile.
« Rien n'égale, au petit matin, la fraîcheur lavée des platures à marée basse, cloisonnées, déchiquetées de larges bras d'eau claire, où bouge et tournoie l'odeur d'un monde naissant l'eau et la nuit en même temps se retirent, une respiration neuve et inconnue, pour quelques instants, nous habite, qui se souvient encore de la branchie – l'eau-mère de nouveau directement nous irrigue : plus native que tous les souvenirs d'enfance, plus pénétrante que tous les flacons de Baudelaire, la fraîcheur, la succulence ténébreuse et iodée que libère une coquille ouverte explose sur la narine comme une humide et profonde patrie….
En dehors des mystérieux ralliements des corbeaux qui crient noir sur la cime des pins, de la fuite silencieuse, rayée de beige, de noir et de blanc, des huppes au travers des sous-bois, sous la voûte des branches où elles volent comme dans une cathédrale, du cri intermittent de la pie, plus rarement du derrière blanc d'un lapin qui dévale une dune, les écureuils sont la seule vie de cette forêt dont le silence et l'immobilité sont si étonnants sous le plein soleil que plus d'une fois je suspends mon pas pour les vérifier et les laisser m'emplir. Vie séparée, cloisonnée, qui n'entre en symbiose avec aucune autre, et flotte dans un espace sylvestre dépeuplé qui semble trop grand pour elle : je songe quelquefois, en surprenant leur grignotis menu cerné de toutes parts par le silence, à la pointe avancée d'une colonie migrante en reconnaissance dans quelque Far-West forestier. L'écureuil n'a jamais l'air d'être, de se sentir chez lui : il patrouille en enfant perdu, progressant par bonds dans les branches supérieures, comme un ranger, un éclaireur des marches boisées, s'arrête, écoute, dresse la tête au vent entre les bouquets de poils de ses oreilles, interroge les carrefours de l'air : il a l'air de frayer la voie à une maraude précautionneuse, ou bien, à la fois exultant et inquiet, de prendre possession, en pionnier, d'une forêt vierge.
Pourquoi l'œil et le pas évitent-ils d'instinct le vide ingrat creusé dans un bois par une coupe forestière ? Chaque matin, quand je me promène dans la forêt de Monts, je me heurte avec le même agacement à une de ces coupes à blanc — de peu d'étendue, mais difficile à contourner — et la courte traversée que j'en entreprends en maugréant fait chaque fois baisser le ton à mon humeur. Alors que la clairière, associée naturellement aux danses des elfes et des fées, s'annonce toujours sur son seul nom comme un enclos favorisé, une enceinte toute riante, un lieu magique de récréation.
J'avance dans la terre cendreuse, tout de suite pulvérulente sous le soleil, boitant entre les débris de branches cassées dans le podzol grossièrement, laidement scarifié par le débardage. De place en place, dans le creux des ondulations des dunes, des ronds de cendre froide, gris et noirs, marquent les brûlis d'écorces et de branchettes. Le jour blanc et cru, hostile, est celui qui tombe dans une grange en ruine par les toits crevés. Bien plus que dans l'incofort de la marche, dans la laideur revêche du sol dénudé, le malaise est là : dans le sentiment qu'on a d'être devant une maison décoiffée où toute une complication d'aménagements anciens et subtils, toute une économie ingénieuse assise sur un long, un séculaire usage, se trouvent brusquement exposées au jour blessant, aux pluies ruineuses, à l'invasion, à l'effroi. »
Ces exemples illustrés par le texte ci-dessus montrent un changement de perspectives .Comme le suggère Julien Gracq le monde nous habite, par sa sonorité, par ses odeurs. L'ensemble fait partie de notre être au monde, et ce n'est plus simplement une question de vue, de distance. « Nous sommes au paysage », un paysage désormais éprouvés avec tous les sens .Les paysages deviennent des ambiances, des atmosphères, des milieux dans lesquels nous sommes plongés, avant d'être des objets à contempler. Nous habitons les paysages avant de les voir.
voir le site:http://www.arno-rafael-minkkinen.com/water_and_sky.html
« Il faudrait s'interroger alors de manière plus précise sur cette notion d'engagement, cette notion d'implication dans le paysage. Si le paysage correspond à notre implication dans le monde, alors cela veut dire qu'il n'est pas loin de nous, dans une sorte de distance, mais au contraire qu'il est proche, que nous sommes à son contact, qu'il nous enveloppe pour ainsi dire. On pourrait même aller jusqu'à dire que c'est ce contact, cet ensemble de contacts avec le monde environnant, bref cette expérience physique, qui fait paysage, qui fait le paysage. La sociologie et l'anthropologie des sens, la géographie culturelle, l'histoire des sensibilités, l'esthétique philosophique, mais aussi de nombreuses études sur les environnements urbains, ont fait apparaître en quoi le paysage prenait en charge une dimension de la relation humaine au monde et à la nature que la science moderne, par principe, avait laissé de côté : le rapport direct, immédiat, physique, aux éléments sensibles du monde terrestre.
L'eau, l'air, la lumière, la terre : autant d'aspects matériels du monde qui sont ouverts aux cinq sens, à l'émotion, à une sorte de géographie affective qui répercute les pouvoirs de retentissement que possèdent les lieux sur l'imagination. Le paysage serait d'abord de l'ordre de l'expérience vécue, sur le plan de la sensibilité Plus précisément, le paysage serait de l'ordre de l'expérience poly-sensorielle, à l'opposé des entreprises« anesthésiques » (R. Sennett) qui caractérisent le monde moderne et contemporain. Contre la phobie moderne du contact avec le monde et avec les autres, le paysage affirmerait au contraire le rôle central des expériences sensorielles dans la fabrication des identités territoriales La question deviendrait alors la suivante : comment reconnaître la « poly-sensorialité » propre au paysage, et, surtout, comment y accéder ? Comment accéder au paysage comme milieu sensoriel ».
Le Paysage, Espace Sensible, Espace Public Jean-Marc Besse EHGO/UMR Géographie-Cités, CNRS/Paris I/Paris VII)
On retrouve ici le rôle déterminant du corps vivant, tel que le développe Merleau-Ponty et tel que l'ont évoqué les articles, le corps sensible est comme le centre et la condition de possibilité des expériences du paysage. A quoi renvoie ici la notion de « corps sensible » ? Il faut rappeler ici la distinction, classique depuis Merleau-Ponty, entre le concept de corps considéré comme objet physique neutre (le corps des sciences physiques : un point matériel auquel on a attribué des propriétés diverses, pesanteur, grandeur, etc., mais c'est un point qui en réalité n'existe pas : c'est une réalité théorique, élaborée par la science), et le corps vivant, senti, vécu, éprouvé de l'intérieur, notre propre corps. Il y a, dit-on encore pour marquer un classique des dissertations philosophiques , d'une part le corps que j'ai et qui peut me paraître parfois comme étranger à moi-même, et d'autre part le corps que je suis, le corps que je vis pour ainsi dire « de l'intérieur », mon corps vivant.
C'est le corps vivant qui est le corps sensible des expériences paysagères poly-sensorielles, qui est le centre des affects, le centre et le réceptacle des spatialités affectives.
La notion d'« habitation », dans cette perspective, acquiert une charge ontologique et phénoménologique : c'est par notre corps propre que nous habitons le monde.
Merleau-Ponty parle du nouage entre espace, action et forme lorsqu'il écrit : « Il n'y aurait pas pour moi d'espace si je n'avais pas de corps. […] C'est évidemment dans l'action que la spatialité du corps s'accomplit […]. On voit mieux, en considérant le corps en mouvement, comment il habite l'espace (et d'ailleurs le temps) parce que le mouvement ne se contente pas de subir l'espace et le temps, il les assume activement.
»
Ce « faire avec l'espace » intéresse précisément nombre de géographes aujourd'hui. Ils nous invitent à considérer les multiples façons dont l'espace est mobilisé comme ressource et conditions de l'action humaine, comment le sujet se construit des référents géographiques d'attachement et d'identification, comment l'expérience forge le sens d'un espace. L'espace ne préexiste pas à la pratique et ce sont les actes en situation qui laissent surgir l'espace, c'est-à-dire « des moments au cours duquel l'espace apparaît à travers les activités des individus
« C'est une autre géographie du monde qui est ici proposée et mise en oeuvre. C'est une géographie qu'on pourrait dire de sensibilité et de sentiment, une géographie affective, de proximité et de contact avec le monde et avec l'espace, et dont on pourrait penser qu'elle est originale, première par rapport à la géographie savante. Tout n'est pas objectivable dans l'expérience géographique
Cette autre géographie est, elle aussi, un savoir de l'espace. Un savoir sans doute plus intime, plus mystérieux, qu'on ne peut le traduire qu'avec peine, qui difficilement communicable dans un discours public et général. C'est un savoir qui exprime en effet une intelligence quotidienne du monde et de l'espace, une familiarité fondée sur l'usage. C'est une géographie vécue autant que pensée. C'est avant tout une manière d'être dans le monde, une expérience et un usage qui se déploient dans l'espace. Mais cela ne signifie pas que ce savoir ne peut pas être dit.
Toute la difficulté, à vrai dire, est de dégager le point de vue d'où nous pourrions saisir cette intimité géographique avec le monde, puis de trouver le langage dans lequel elle peut être exprimée, traduite, ou, pour mieux dire, dans quelles phrases cette géographie intime peut résonner. On ne peut se contenter de dire qu'on aurait affaire là à une géographie subjective, qu'on viendrait opposer pièce par pièce à la géographie savante et objective. Car l'intimité avec le monde dont il s'agit ici n'est pas privée, elle n'est pas repliée sur elle-même comme sur une intériorité personnelle. Il n'est pas sûr, d'ailleurs, qu'il y ait quelque chose comme « un intérieur » dans cette histoire. La géographie vécue, c'est-à-dire le contact familier avec le monde et l'espace, n'est pas une géographie intérieure, une géographie de l'intériorité subjective, un « paysage de l'âme ». Si la subjectivité est impliquée dans cette expérience ou cette géographie (deux mots, peut-être, pour la même chose), elle n'est pas repliée sur elle-même à l'exclusion du monde et de l'espace. Elle est de part en part spatiale, mobilisée par l'espace, déplacée dans l'espace, elle traverse l'espace. Elle est dehors, à l'extérieur. » Le Paysage, Espace Sensible, Espace Public Jean-Marc Besse
L'auteur souligne ainsi toute l'importance de la notion et de l'expérience de l'exposition : « s'exposer à », « exposer son corps à » comme l'expérience du paysage, dans la rencontre de l'extériorité sous ses formes les plus concrètes (lumière, température, qualité de l'air, odeurs, etc.). « Narration » ambulatoire contre regard « cartographique » : Tout se passe comme si les « élites » et les urbains( ce furent à l'origine les lettrés chinois, l'aristocratie ,la bourgeoisie, les artistes) auparavant fondateurs du paysage /panorama avaient désormais le sentiment d'une perte de contact avec le monde(le paysage n'est pas le pays, ni le monde du paysan) ;une nostalgie de l'origine qui s'exprime par exemple par la redécouverte de la marche le long des sentiers de Grande Randonnée, les drailles de transhumance cévenoles ou l'itinéraire du pèlerinage de st jacques de Compostelle.
J.Marc Besse met ainsi en avant l'importance de la marche, comme exemple fondateur .il la comprend comme l'élaboration d'un espace psychique d'un genre particulier : celui des rythmes spatiaux et des intensités spatiales, que l'on ne peut saisir que par elle. » .
La marche « requalifie » l'espace d'une certaine manière, elle possède une vertu performative : le déplacement a le pouvoir de créer des formes ». En tant que rapport à l'espace, elle met en œuvre une spatialité spécifique. Une spatialité qui repose en particulier sur les investissements corporels, physiques, de l'espace par les sujets qui s'y déplacent et qui y vivent. Ainsi ce ressenti particulier qu'est fatigue dans la marche, à propos de laquelle il cite Nicolas Bouvier,(dont l'ouvrage principal porte le titre évocateur « D'usage Du Monde »), parlant de sa porosité vis-à-vis du monde, qui lui restitue sa capacité à être affecté par les données sensibles du monde. « La fatigue, écrit encore Julien Gracq à son tour, agit comme le fixateur sur l'épreuve photographique ; l'esprit, qui perd une à une ses défenses, doucement stupéfié, doucement rompu par le choc du pas monotone, l'esprit bat nu la campagne, s'engoue tout entier d'un rythme qui l'obsède, d'un éclairage qui l'a séduit, du suc inestimable de l'heure qu'il est ».
« Mais je ne dirais pas que le voyage distille une forme de connaissance dont il aurait le monopole. Un moine cistercien peut avoir le même genre de satori ou d'illumination en priant dans sa cellule, ou un homme à cheval sur une dame. L'émoi erotique est un moyen de connaissance spirituelle. Ça peut aussi être l'alcool, l'éther, le sentiment mystique, des états de fatigue physique extrême. Je fais une grande confiance à la fatigue, et ce que je reproche aujourd'hui à mon corps, c'est de ne plus être capable de me fatiguer jusqu'au bout, jusqu'aux moments d'épuisement total qui peuvent se produire après une très longue marche. Maintenant, je vais à petits pas parce que mes limites physiques se sont rétrécies. La marche est aussi un processus de connaissance et d'illumination. D'une part à cause de son rythme, d'autre part parce que, comme il faut vraiment se concentrer sur la façon de poser les pieds, sur où on les met, sur comment ménager son souffle, ça occupe la totalité de l'esprit. Quelquefois, au bout de très longues marches, non pas au but, mais en vue du but, lorsque vous savez que vous l'atteindrez, se produit une sorte d'irruption du monde dans votre mince carcasse, fantastique, dont on ne parvient pas à rendre compte avec les mots.
En fin d'après-midi j'ai quitté Shiraoï.
Le ciel se couvrait: j'avais envie de marcher et j'ai décidé de regagner Noboribetsu par la plage. J'ai traversé le marécage qui s'étend entre la mer et la route et atteint de longues dunes de sable noir semées de racines couleur d'ossements. Pas une âme, pas une trace de pas. Ici et là, la double empreinte profonde laissée par un phoque, et des nappes de brouillard qui circulaient à des allures d'autobus. J'ai enlevé mes chaussures et foulé le sable en écoutant le cri gelé des mouettes et le ressac de vagues invisibles. J'avais vingt kilomètres de plage pour moi, je me répétais: la mer... la rner, et j'étais content. Les plaisirs les plus simples sont les meilleurs. Au bout d'une heure, la nuit est tombée comme une pierre et je me suis trouvé arrêté par un chenal qui reliait la mer à la lagune. En me penchant, je pouvais voir un fort courant rider la surface, mais je ne voulais pas revenir sur mes pas et l'idée de traverser le marais dans le noir ne me disait rien qui vaille. J'ai mis mes habits dans ma sacoche, la sacoche sur ma tête, et me suis engagé dans le chenal. Beaucoup plus profond que je ne le pensais, et le reflux déportait violemment vers le large.
J'avais peur de marcher sur un oursin, un tesson, une holoturie. Au beau milieu j'ai manqué trébucher et, précisément là, par une nuit d'encre, en équilibre instable dans ce fort courant, de l'eau jusqu'au^ aisselles, j'ai vu l'ami qu'Éliane héberge en mon absence sortir de notre lit, à mille kilomètres de là, en s'étirant insupportablement Lorsqu'un gribouille comme moi va s'égarer sans profit dans des lieux aussi déshérités, il n'est pas du tout maître de ce genre d'images. Foudroyé par ce soupçon absurde, j'ai bien failli démarter comme un bouchon vers le large et rejoindre l'armée de fanion vengeurs qui hantent le détroit de Tsugaru, Bien heureusement j'al repris pied presque aussitôt. Se noyer sur cette pensée ! Moi qui me suis toujours souhaité une belle mort...
« De l'autre côté, en frottant beaucoup d'allumettes, j'ai trouvé un passage qui m'a guidé à travers le marais jusqu'à la route en évitant {es sables mouvants. J'étais transi et trempé. Vainement tenté d'arrêter une voiture. La nuit et le brouillard rendent les gens peureux, c'est normal. Cela m'a beaucoup rajeuni de brandir le poing et de crier «salaud» à des feux arrière de camions qui s'éloignent. » Nicolas Bouvier .Œuvres.
.






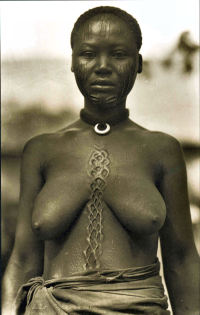
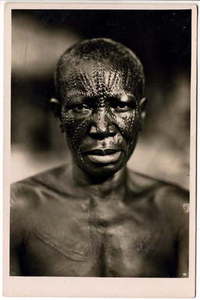












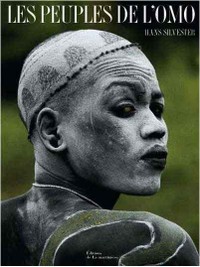





































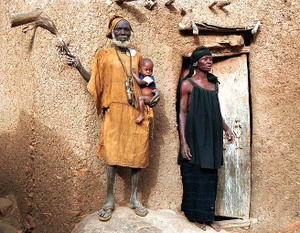













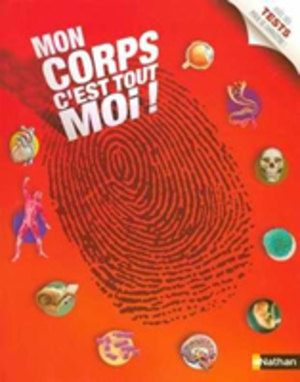
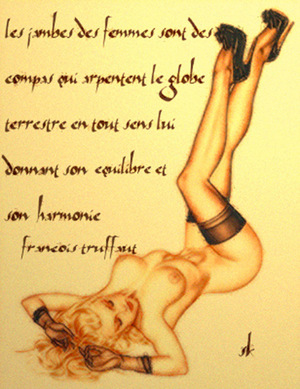











Les commentaires récents